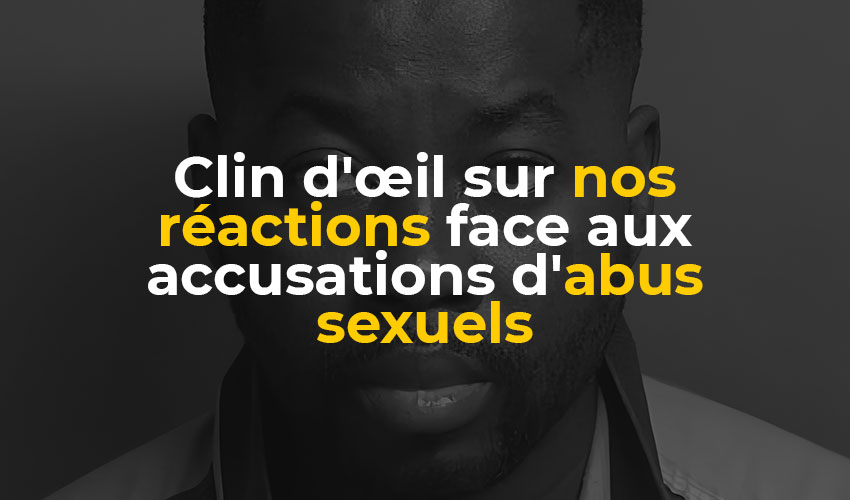
“Clin d’œil sur nos réactions face aux accusations d’abus sexuels”
À chaque nouvelle accusation d’abus ou d’agression sexuelle impliquant un Haïtien, que ce soit en Haïti ou dans la diaspora, un même schéma se répète. L’opinion publique se divise, et au lieu d’un débat lucide sur la gravité des faits allégués, surgissent des réactions qui choquent par leur violence symbolique : remise en question de la possible victime, compassion immédiate pour l’accusé, et une méfiance systématique envers les institutions judiciaires haïtiennes ou étrangères.
Quand la compassion se trompe de camp
Sur les réseaux sociaux, il n’est pas rare d’entendre des phrases comme : « Timoun Etazini ka akize paran yo lè yo bezwen libète », « Timoun Etazini engra », « Fòk nou fè pridans ak timoun yo », « Lekòl konn jwe nan tèt timoun pou fè yo pale », etc.
Ces propos, au-delà de leur apparente banalité, traduisent un malaise profond dans notre culture collective. Ils révèlent notre difficulté à concevoir qu’un adulte respecté puisse être un agresseur, et qu’un enfant puisse dire la vérité. Au lieu de suspendre notre jugement ou d’écouter avec prudence, nous défendons spontanément l’adulte et piétinons la parole de la possible victime.
Ce que disent la loi américaine et la loi haïtienne par exemple
Dans le système judiciaire des États-Unis, une accusation de “sexual assault of a child” ou de viol ne repose pas sur une simple parole ou un caprice. Elle suppose :
– Un contact ou comportement sexuel avec un mineur en dessous de l’âge légal du consentement (Qui varie entre 16 et 18 ans selon les États) ;
– Des éléments de preuve suffisants pour justifier une arrestation ou une inculpation ;
– Et une procédure rigoureuse, encadrée par des enquêteurs spécialisés en crimes contre mineurs.
Autrement dit, on ne “joue” pas avec une accusation d’abus sexuel sur enfant. Elle implique toujours une démarche sérieuse et fondée sur des preuves. Pourtant, une partie de notre société préfère croire à l’exagération ou à la manipulation plutôt qu’à la possibilité d’un crime réel. De plus, en Haïti, la loi est sans équivoque car l’article 279 du Code pénal sanctionne sévèrement les violences et abus contre les mineurs, avec des peines allant jusqu’à 30 ans de réclusion criminelle. Ainsi, toute atteinte à l’intégrité d’un enfant n’est pas une affaire privée, mais un crime grave que la société et l’État doivent condamner sans complaisance.
Une culture qui banalise la douleur des enfants
Cette tendance à minimiser la parole des victimes, surtout quand elles sont jeunes, s’explique en partie par :
– Une mentalité patriarcale qui sacralise l’autorité masculine et parentale ;
– Une éducation autoritaire où la soumission vaut vérité ;
– Et une méfiance culturelle envers les systèmes de justice étrangers, perçus comme “contre nos valeurs”.
Mais derrière ces réflexes, il y a une vérité dérangeante : nous confondons respect et impunité.
Chaque fois qu’une victime est ridiculisée, des dizaines d’autres choisissent le silence. Combien de jeunes filles, de jeunes garçons, en Haïti ou ailleurs, ont préféré taire leur douleur, de peur d’être traités de menteurs ou d’ingrats ?
Nous envoyons ainsi un message dangereux : « Mieux vaut souffrir en silence que de passer pour un traître ».
Vers une nouvelle culture de responsabilité
Il est urgent de repenser notre manière de réagir aux accusations d’abus. Nous devons apprendre à :
– Faire confiance à la justice et attendre ses conclusions ;
– Écouter sans juger, surtout les enfants ;
– Reconnaître que même les figures aimées peuvent faillir ;
– Et surtout, protéger les victimes avant de protéger les réputations.
Tant que notre réflexe sera de défendre “les nôtres” avant d’écouter les blessés, aucun progrès social réel n’est possible. Changer cette mentalité, c’est commencer à bâtir une société qui valorise la vérité, la justice et la dignité humaine. Et si l’affaire récente de Markendy Datus, accusé aux États-Unis d’abus sexuel sur mineur, a autant secoué la diaspora haïtienne, c’est peut-être parce qu’elle met en lumière, une fois de plus, notre plus grand tabou collectif : la difficulté à croire les possibles victimes et à attendre le verdict de la justice avant de prendre parti.






